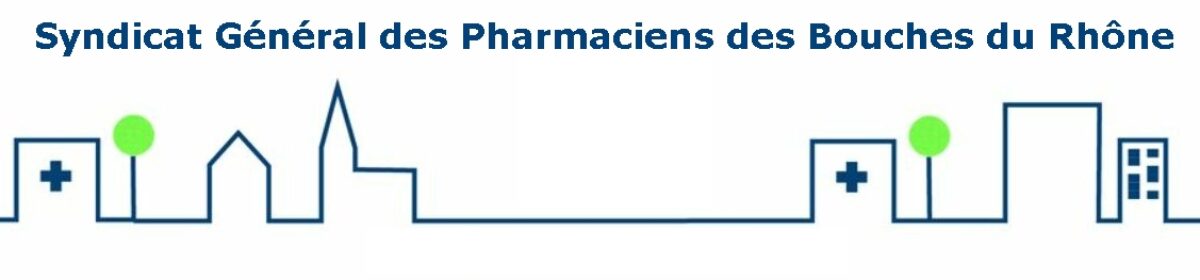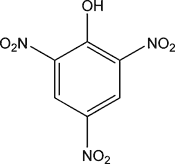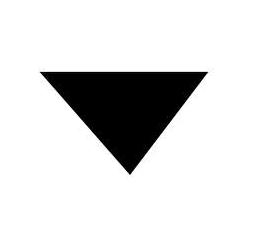La FSPF lance une enquête
____
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé l’obligation d’aménagement des établissements recevant du public (ERP), afin de permettre l’accès et la circulation de toutes les personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique).
A compter du 1er janvier 2015, les ERP devront être en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap : les locaux dans lesquels exercent les professionnels de santé sont donc concernés.
Compte tenu des difficultés économiques que connaissent un grand nombre d’officines, nous avons l’intention d’alerter les Pouvoirs publics et de demander, en tant que de besoin, la mise en place de mesures dérogatoires. Afin d’étayer notre demande, nous souhaiterions disposer de données factuelles nous permettant de mieux appréhender l’étendue des difficultés rencontrées sur le terrain. C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré un court questionnaire à destination des pharmaciens d’officine.
Vous pouvez accéder à ce court questionnaire en cliquant sur le lien suivant : Sondage FSPf accessibilité personnes handicapées
Ce questionnaire est adressé par courriel à l’ensemble des adhérents des syndicats départementaux affiliés à la FSPF. Si vous l’avez déjà reçu, il importe de n’y répondre qu’une seule fois, en qualité de pharmacien adhérent.
Ce questionnaire doit-être rempli en ligne et validé avant le 12 mai 2012 afin de nous mettre à même de l’exploiter.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration active. Un taux de réponse significatif est nécessaire pour que la FSPF puisse valablement faire état auprès des Pouvoirs publics des difficultés éventuellement soulevées par la mise en œuvre de la réforme de l’accessibilité des ERP aux personnes handicapées.
Jocelyne WITTEVRONGEL
Vice-présidente