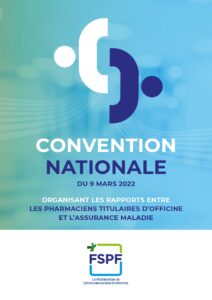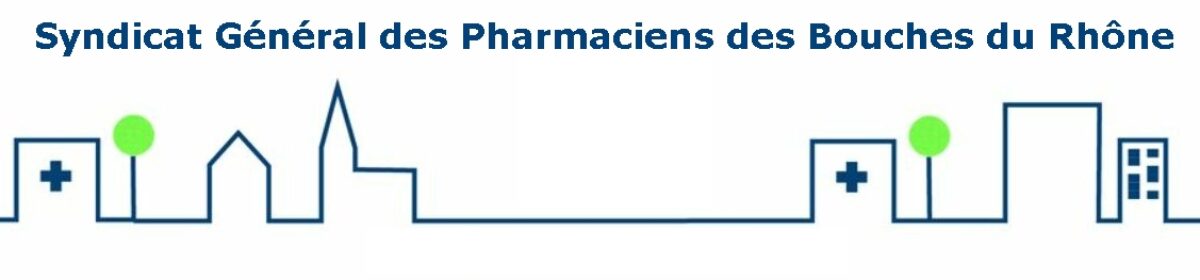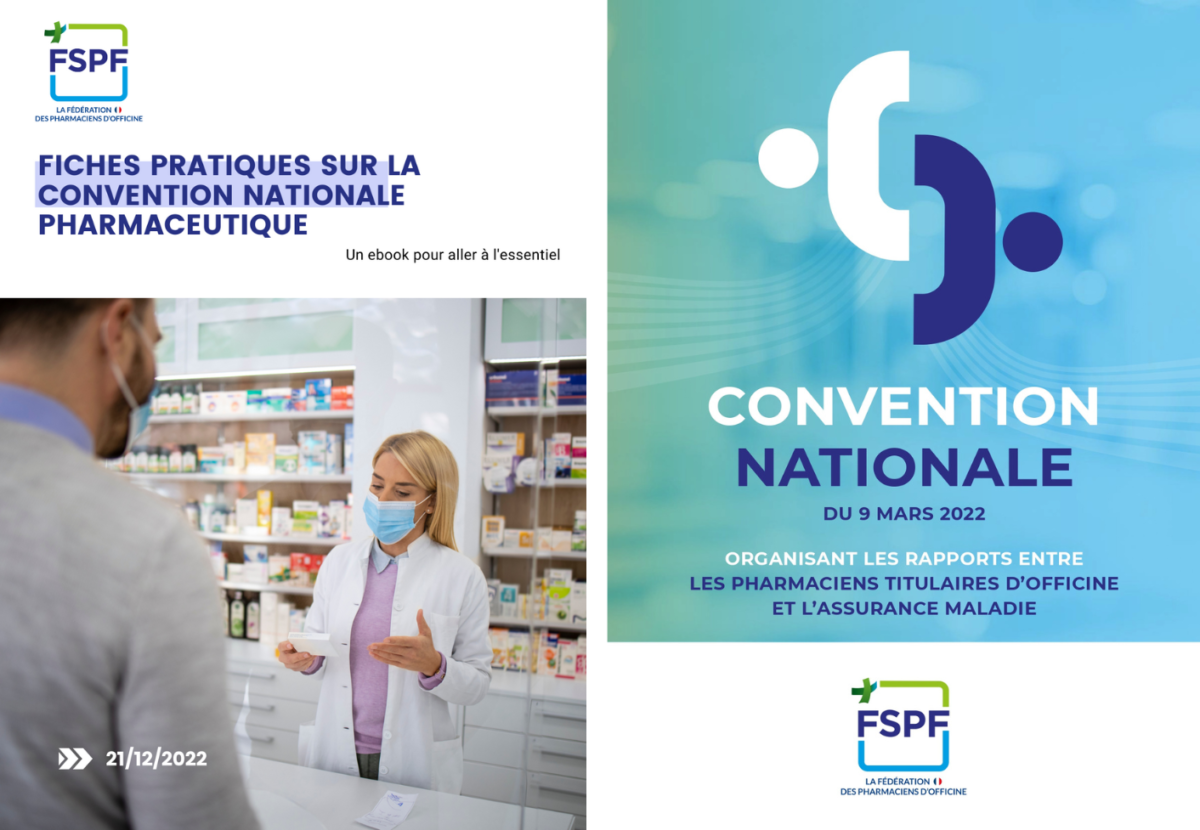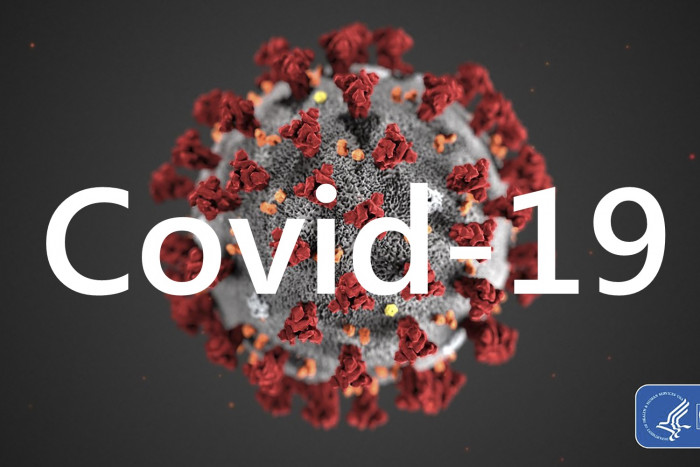Au 1er février 2023, plusieurs mesures dérogatoires liées au Covid-19 évoluent, en application de la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19.
- Cas contacts assurance maladie : fin de la prise en charge des tests antigéniques et fin de la délivrance gratuite de masques et d’autotests
A compter du 1er février 2023, il est mis fin au téléservice « Contact Covid » (contact tracing) de l’Assurance maladie. Celle-ci cesse donc l’envoi de notifications aux personnes contacts.
En conséquence, plus aucune prise en charge n’est accordée aux personnes contacts.
En pratique, cela a pour effet de mettre fin à :
- la prise en charge des tests antigéniques pour les personnes contacts ;
- la délivrance de masques (30) à titre gratuit aux personnes contacts ;
- la délivrance d’autotests (1) à titre gratuit aux personnes contacts.
La prise en charge continue de s’appliquer pour les autres catégories de personnes listées dans l’arrêté du 1er juin 2021, notamment pour les personnes vaccinées mais également pour les mineurs, les personnes ayant une contre-indication à la vaccination, etc.
A ce jour, l’arrêté du 1er juin 2021 n’ayant pas été modifié, il reste possible de délivrer des autotests à certaines personnes contacts sur la base de justificatifs autres que la notification de l’Assurance maladie (par exemple : courrier de l’Education nationale ou attestation sur l’honneur pour les élèves).
Le ministère de la Santé nous a toutefois informés que cet arrêté devra être modifié très prochainement et que la notion de cas contact est amenée à disparaître complètement.
Téléchargez notre tableau sur la dispensation des masques et des autotests en cliquant ici.
- SI-DEP : le consentement oral du patient est requis
A compter du 1er février 2023, l’usage de SI-DEP pour la génération d’une attestation de résultat de test est conditionné au recueil préalable du consentement du patient.
Dans SI-DEP, vous devrez cocher une case indiquant que le patient a donné son consentement oral. Dans ce cas, le résultat du test sera généré dans une attestation (utile notamment pour voyager). Le patient peut revenir sur son consentement à tout moment et vous devrez décocher la case dans SI-DEP.
En l’absence de demande de consentement ou en l’absence de consentement, vous devrez toujours renseigner SI-DEP (en veillant à ne pas cocher la case « consentement ») mais les données seront pseudonymisées, à des fins statistiques/épidémiologiques et aucune attestation ne sera générée. Dans ce cas, le patient ne peut plus changer d’avis et donner finalement son consentement.
A noter : pour les personnes pour lesquelles les tests antigéniques restent remboursés, l’absence de consentement ne fait pas obstacle à la prise en charge. Vous continuez de facturer à l’Assurance maladie, dans les conditions habituelles.
- Vaccination : fin de l’ouverture exceptionnelle le dimanche
Jusqu’au 31 janvier 2023, les officines participant à la campagne de vaccination contre la Covid-19, et n’étant pas de garde, étaient autorisées à ouvrir le dimanche, sans avoir à rester ouvertes pendant toute la durée du service de garde.
Cette mesure a pris fin le 1er février 2023.
- Mesures concernant les salariés
Une circulaire sera adressée aux adhérents dans la journée.
- Autres mesures concernant l’exercice officinal
Les mesures dérogatoires liées au Covid-19 et concernant l’exercice officinal (autorisation de vacciner, réalisation des tests, délivrance des vaccins, tests et masques…) se poursuivent.
A ce jour, aucune date de fin de ces mesures n’est annoncée.
Dans l’attente d’éléments plus précis des pouvoirs publics, vous pouvez donc continuer à mettre en œuvre ces mesures dérogatoires. Nous vous recommandons toutefois d’anticiper la fin de ces mesures, pouvant intervenir soudainement, afin notamment d’éviter un stockage trop important de tests et de masques.